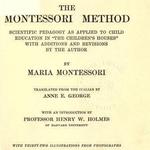Chapitre 13 - Education des sens et illustrations du matériel didactique : Sensibilité générale : Les sens tactiles, thermiques, basiques et stéréognostiques
La méthode Montessori, 2e édition - Restauration
# Chapitre 13 - Education des sens et illustrations du matériel didactique : Sensibilité générale : Les sens tactiles, thermiques, basiques et stéréognostiques
## [13.1 Education des sens tactiles, thermiques et bariques](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapter+13+-+Education+of+the+senses+and+illustrations+of+the+didactic+material%3A+General+sensibility%3A+The+tactile%2C+thermic%2C+basic%2C+and+stereo+gnostic+senses#13.1-education-of-the-tactile%2C-thermic%2C-and-baric-senses 'Lien vers le texte de base de traduction de Montessori.Zone "La méthode Montessori"')
L'éducation des sens tactile et thermique va de pair, puisque le bain chaud et la chaleur en général rendent le sens tactile plus aigu. Puisque pour exercer le sens tactile il faut ***toucher*** , le bain des mains dans l'eau tiède a l'avantage supplémentaire d'apprendre à l'enfant un principe de propreté celui de ne pas toucher les objets avec des mains qui ne sont pas propres. J'applique donc les notions générales de la vie pratique, relatives au lavage des mains et au soin des ongles, aux exercices préparatoires à la discrimination des excitations tactiles.
La limitation des exercices du sens tactile aux bouts rembourrés des doigts est rendue nécessaire par la vie pratique. Il faut en faire une étape nécessaire de ***l'éducation*** parce qu'elle prépare à une vie où l'homme exerce et utilise le sens tactile par l'intermédiaire de ces doigts. Je fais donc laver soigneusement à l'enfant les mains avec du savon, dans une petite bassine ; et dans une autre bassine, je lui fais rincer dans un bain d'eau tiède. Ensuite, je lui montre comment sécher et frotter doucement ses mains, se préparant ainsi au bain habituel. J'enseigne ensuite à l'enfant comment *toucher* , c'est-à-dire la manière dont il doit toucher les surfaces. Pour cela, il faut prendre le doigt de l'enfant et le tirer ***très, très légèrement sur la surface** .*
Une autre technique particulière consiste à apprendre à l'enfant à garder les yeux fermés pendant qu'il touche, en l'encourageant à le faire en lui disant qu'il pourra mieux sentir les différences, et en l'amenant ainsi à distinguer, sans l'aide de la vue, les changement de contact. Il apprendra rapidement et montrera qu'il aime l'exercice. Souvent, après l'introduction de tels exercices, il est courant de faire venir à vous un enfant, et, fermant les yeux, de toucher avec une grande délicatesse la paume de votre main ou le tissu de votre robe, surtout les garnitures de soie ou de velours. . *Ils exercent* vraiment le sens tactile. Ils aiment toucher vivement toute surface douce et agréable et deviennent extrêmement désireux de faire la distinction entre les différences entre les cartes de papier de verre.
Le matériel didactique se compose de
* *a* – une planche de bois rectangulaire divisée en deux rectangles égaux, l'un recouvert de papier très lisse, ou dont le bois est poli jusqu'à l'obtention d'une surface lisse ; l'autre recouvert de papier de verre.
* *b* - une tablette comme la précédente recouverte d'une alternance de bandes de papier lisse et de papier de verre.
J'utilise également une collection de bouts de papier, variant à travers de nombreuses qualités allant du carton lisse et fin au papier de verre le plus grossier. Les types de choses décrites ailleurs sont également utilisés dans ces leçons.
Quant au Thermic Sense, j'utilise un ensemble de petits bols en métal, qui sont remplis d'eau à différents degrés de température. J'essaie de les mesurer avec un thermomètre, afin qu'il y en ait deux contenant de l'eau à la même température.

> **L'école du cloître des religieuses franciscaines à Rome\
> Enfants jouant à un jeu avec des tablettes de soie colorée.**
 Fille touchant une lettre et garçon racontant des objets en fonction de leur poids. (B) Disposer les comprimés de soie dans leur ordre chromatique en fonction du poids.")
> **(A) Fille touchant une lettre et garçon racontant des objets en fonction de leur poids.\
> (B) Disposer les comprimés de soie dans leur ordre chromatique en fonction du poids.**
Il y a huit couleurs et huit nuances de chaque couleur, soit soixante-quatre dégradés en tout.
J'ai conçu un ensemble d'ustensiles qui doivent être en métal très léger et remplis d'eau. Ceux-ci ont des couvercles, et à chacun est attaché un thermomètre. Le bol touché de l'extérieur donne l'impression de chaleur recherchée.
Je fais aussi plonger les enfants dans l'eau froide, tiède et tiède, exercice qu'ils trouvent des plus divertissants. Je voudrais répéter cet exercice avec les pieds, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en faire l'essai.
Pour l'éducation du sens barique (sens du poids), j'utilise avec beaucoup de succès de petites tablettes de bois, six par huit centimètres, ayant une épaisseur de 1/2 centimètre. Ces tablettes sont en trois qualités différentes de bois, glycine, noyer et pin. Ils pèsent respectivement 24, 18 et 12 grammes, ce qui les fait différer en poids de 6 grammes. Ces comprimés doivent être très lisses ; si possible, vernis de manière à éliminer toute rugosité, mais à conserver la couleur naturelle du bois. L'enfant, ***observant*** la couleur, ***sait*** qu'ils sont de poids différents, ce qui offre un moyen de contrôler l'exercice. Il prend deux des comprimés dans ses mains, les laissant reposer sur la paume à la base de ses doigts tendus. Puis il déplace ses mains de haut en bas afin de jauger le poids. Ce mouvement devrait devenir, peu à peu, presque insensible. Nous amenons l'enfant à faire sa distinction uniquement par la différence de poids, en laissant de côté le guide des différentes couleurs et en fermant les yeux. Il apprend à le faire par lui-même et s'intéresse beaucoup aux « devinettes ».
Le jeu attire l'attention des proches, qui se rassemblent en cercle autour de celui qui a les tablettes, et qui se relaient pour ***deviner** .* Parfois, les enfants se servent spontanément du bandeau, se relaient et entrecoupent le travail d'éclats de rire joyeux.
## [13.2 Éducation du sens de la stéréognose](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapter+13+-+Education+of+the+senses+and+illustrations+of+the+didactic+material%3A+General+sensibility%3A+The+tactile%2C+thermic%2C+basic%2C+and+stereo+gnostic+senses#13.2-education-of-the-stereognosis-sense 'Lien vers le texte de base de traduction de Montessori.Zone "La méthode Montessori"')
L'éducation de ce sens conduit à la reconnaissance des objets par le toucher, c'est-à-dire par l'aide simultanée des sens tactile et musculaire.
Partant de cette union, nous avons fait des expériences qui ont donné des résultats pédagogiques merveilleusement réussis. Je pense qu'avec l'aide des enseignants, ces exercices devraient être décrits.
Le premier matériel didactique que nous utilisons est constitué des briques et des cubes de Froebel. On appelle l'attention de l'enfant sur la forme des deux solides, on lui fait sentir avec soin et précision, les yeux ouverts, en répétant quelque phrase servant à fixer son attention sur les particularités des formes présentées. Après cela, on dit à l'enfant de placer les cubes à droite et les briques à gauche, en les sentant toujours et sans les regarder. Enfin, l'exercice est répété, par l'enfant les yeux bandés. Presque tous les enfants réussissent l'exercice et, après deux ou trois fois, sont capables d'éliminer toutes les erreurs. Il y a vingt-quatre briques et cubes en tout, de sorte que l'attention peut être retenue pendant un certain temps à travers ce "jeu", mais sans aucun doute l'enfant'
Un jour, une directrice m'appela sur une petite fille de trois ans, une de nos très jeunes élèves, qui avait parfaitement répété cet exercice. Nous avons installé la petite fille confortablement dans un fauteuil, près de la table. Puis, plaçant les vingt-quatre objets devant elle sur la table, nous les mélangeâmes, et attirant l'attention de l'enfant sur la différence de forme, lui dit de placer les cubes à droite et les briques à gauche. Quand elle eut les yeux bandés, elle commença l'exercice tel que nous l'enseignions, prenant un objet dans chaque main, palpant chacun et le mettant à sa place. Parfois elle prenait deux cubes ou deux briques, parfois elle trouvait une brique dans sa main droite et un cube dans la gauche. L'enfant devait reconnaître la forme et se souvenir tout au long de l'exercice du bon placement des différents objets.
Mais en l'observant, j'ai vu que non seulement elle exécutait facilement l'exercice, mais que les mouvements avec lesquels nous lui avions appris à sentir la forme étaient superflus. En effet à l'instant où elle avait pris les deux objets dans ses mains s'il arrivait qu'elle ait pris un cube de la main gauche et une brique de la droite, elle les *échangea **aussitôt*** et commença *alors* la pénible sensation de la forme que nous avions enseignée et qu'elle croyait peut-être obligatoire. Mais les objets avaient été reconnus par elle ***au premier toucher léger** ,* c'est-à-dire que la ***reconnaissance était contemporaine de la prise** .*
Poursuivant mon étude du sujet, j'ai trouvé que cette petite fille possédait une remarquable ***ambidextrie fonctionnelle*** remarquable. Je serais très heureux de faire une étude plus large de ce phénomène en vue de l'opportunité d'une éducation simultanée des deux mains.
J'ai répété l'exercice avec d'autres enfants et j'ai constaté qu'ils ***reconnaissaient*** les objets avant de sentir leurs contours. C'était particulièrement vrai des ***plus petits** .* Nos méthodes pédagogiques ont fourni à cet égard un remarquable exercice de gymnastique associative, entraînant une rapidité de jugement vraiment surprenante et ayant l'avantage d'être parfaitement adaptée aux très jeunes enfants.
Ces exercices du sens stéréognostique peuvent être multipliés de bien des façons : ils amusent les enfants qui se délectent de la reconnaissance d'un stimulus, comme dans les exercices thermiques ; par exemple, ils peuvent soulever tous les petits objets, soldats de plomb, petites balles et, surtout, les différentes pièces de ***monnaie*** de monnaie d'usage courant. Ils en viennent à discriminer de petites formes variant très peu, comme le maïs, le blé et le riz.
Ils sont très fiers de *voir sans yeux,* tendant les mains et criant : « Voici mes yeux ! "Je peux voir avec mes mains !" En effet, nos bouts de chou marchant dans les chemins que nous avons prévus, nous font nous émerveiller de leurs progrès imprévus, nous surprenant au quotidien. Souvent, alors qu'ils sont fous de joie sur une nouvelle conquête, nous les regardons, dans l'émerveillement et la méditation les plus profonds.
## [13.3 Education des sens du goût et de l'odorat](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapter+13+-+Education+of+the+senses+and+illustrations+of+the+didactic+material%3A+General+sensibility%3A+The+tactile%2C+thermic%2C+basic%2C+and+stereo+gnostic+senses#13.3-education-of-the-senses-of-taste-and-smell 'Lien vers le texte de base de traduction de Montessori.Zone "La méthode Montessori"')
Cette phase de l'éducation sensorielle est des plus difficiles, et je n'ai pas encore eu de résultats satisfaisants à enregistrer. Je peux seulement dire que les exercices habituellement utilisés dans les tests de psychométrie ne me semblent pas pratiques à utiliser avec de jeunes enfants.
Le sens olfactif chez les enfants n'est pas très développé, ce qui rend difficile d'attirer leur attention au moyen de ce sens. Nous avons utilisé un test qui n'a pas été répété assez souvent pour constituer la base d'une méthode. Nous faisons sentir à l'enfant les violettes fraîches et les fleurs de jasmin. Nous lui bandons alors les yeux en disant; "Maintenant, nous allons vous offrir des fleurs." Un petit ami tient alors un bouquet de violettes sous le nez de l'enfant, afin qu'il devine le nom de la fleur. Pour plus ou moins d'intensité, nous présentons moins de fleurs ou même une seule fleur.
 Table à dessin et encarts. (B) Tablettes en bois. Ceux-ci sont en partie recouverts de papier de verre pour donner des surfaces rugueuses et lisses. (C) Encarts pleins. Avec ceux-ci, l'enfant, travaillant seul, apprend à différencier les objets selon l'épaisseur, la hauteur et la taille.")
> **(A) Table à dessin et encarts.\
> (B) Tablettes en bois. Ceux-ci sont en partie recouverts de papier de verre pour donner des surfaces rugueuses et lisses.\
> (C) Encarts pleins. Avec ceux-ci, l'enfant, travaillant seul, apprend à différencier les objets selon l'épaisseur, la hauteur et la taille.**
* Large escalier. (B) Grand escalier. (C) Tour.")*
> **(A) Escalier large.\
> (B) Grand escalier.\
> (C) Tour.**
Blocs par lesquels les enfants apprennent l'épaisseur, la longueur et la taille.
Mais cette partie de l'éducation, comme celle du sens du goût, peut être acquise par l'enfant à l'heure du déjeuner où il peut apprendre à reconnaître diverses odeurs.
Quant au goût, la méthode de toucher la langue avec diverses solutions, amères ou acides, sucrées, salées, est parfaitement applicable. Les enfants de quatre ans se prêtent volontiers à de tels jeux, qui servent de prétexte pour leur apprendre à se rincer parfaitement la bouche. Les enfants s'amusent à reconnaître différentes saveurs, et apprennent, après chaque essai, à remplir un verre d'eau tiède, et à se rincer soigneusement la bouche. Ainsi, l'exercice du goût est aussi un exercice d'hygiène.
## [13.4 Éducation du sens de la vue](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapter+13+-+Education+of+the+senses+and+illustrations+of+the+didactic+material%3A+General+sensibility%3A+The+tactile%2C+thermic%2C+basic%2C+and+stereo+gnostic+senses#13.4-education-of-the-sense-of-vision 'Lien vers le texte de base de traduction de Montessori.Zone "La méthode Montessori"')
***I. Perception visuelle différentielle des dimensions***
***Première** .* Inserts solides : Ce matériau se compose de trois blocs de bois massifs de 55 centimètres de long, 6 centimètres de haut et 8 centimètres de large chacun. Chaque bloc contient dix pièces en bois, placées dans des trous correspondants. Ces pièces sont de forme cylindrique et se manipulent au moyen d'un petit bouton en bois ou en laiton fixé au centre du plateau. Les boîtes de cylindres ressemblent beaucoup aux boîtes de poids utilisées par les chimistes. Dans le premier jeu de la série, les cylindres sont tous de hauteur égale (55 millimètres) mais de diamètre différent. Le plus petit cylindre a un diamètre de 1 centimètre et les autres augmentent de diamètre au rythme de 1/2 centimètre. Dans la deuxième série, les cylindres sont tous de diamètres égaux, correspondant à la moitié du diamètre du plus grand cylindre de la série précédente (27 millimètres). Les cylindres de cet ensemble diffèrent par leur hauteur, le premier n'étant qu'un petit disque d'un centimètre de haut seulement, les autres augmentant de 5 millimètres chacun, le dixième mesurant 55 millimètres de haut. Dans le troisième ensemble, les cylindres diffèrent à la fois en hauteur et en diamètre, le premier mesurant 1 centimètre de haut et 1 centimètre de diamètre, et chacun suivant augmentant de 1/2 centimètre de hauteur et de diamètre. Avec ces encarts, l'enfant, travaillant seul, apprend à différencier les objets selon ***épaisseur** ,* selon la ***hauteur** ,* et selon la ***taille** .*
Dans la salle de classe, ces trois décors peuvent être joués par trois enfants réunis autour d'une table, un échange de jeux apportant de la variété. L'enfant sort les cylindres des moules, les mélange sur la table, puis les remet chacun dans l'ouverture correspondante. Ces objets sont en pin dur, polis et vernis.
***Deuxième** .* Grandes pièces de dimensions graduées : Il existe trois ensembles de blocs qui relèvent de cette catégorie, et il est souhaitable d'avoir deux de chacun de ces ensembles dans chaque école.
* ( *a* ) Épaisseur : cet ensemble se compose d'objets qui varient d' ***épais*** à ***mince** .* Il y a dix prismes quadrilatéraux dont le plus grand a une base de 10 centimètres, les autres diminuant de 1 centimètre. Les morceaux sont de longueur égale, 20 centimètres. Ces prismes sont colorés en brun foncé. L'enfant les mélange, les éparpille sur le petit tapis, puis les met en ordre, les plaçant les uns contre les autres selon les graduations d'épaisseur, en veillant à ce que la longueur corresponde exactement. Ces blocs, pris du premier au dernier, forment une espèce d' ***escalier** ,* dont les marches s'élargissent vers le haut. L'enfant peut commencer par le morceau le plus fin ou par le plus gros, selon son plaisir. Le contrôle de l'exercice n'est pas certain, comme c'était le cas dans les encarts cylindriques pleins. Là, les gros cylindres ne pourraient pas entrer dans la petite ouverture, les plus grands dépasseraient du haut du bloc, etc. Dans ce jeu du Grand Escalier, l' *œil* de l'enfant peut facilement reconnaître une erreur, car s'il se trompe, l' ***escalier*** est irrégulier, c'est-à-dire qu'il y aura une marche haute, derrière laquelle la marche qui aurait dû monter, décroît.
* ( *b* ) Longueur : Objets longs et courts : Cet ensemble **se compose de *dix réglettes*** . Celles-ci sont à quatre côtés, chaque face mesurant 3 centimètres. La première tige mesure un mètre de long et la dernière un décimètre. Les tiges intermédiaires diminuent, du premier au dernier, de 1 décimètre chacune. Chaque case de 1 décimètre est peinte alternativement ***en rouge*** ou en ***bleu** .* Les tiges, lorsqu'elles sont placées à proximité les unes des autres, doivent être disposées de manière à ce que les couleurs correspondent, formant autant de bandes transversales - l'ensemble lorsqu'il est disposé a l'apparence d'un triangle rectangle composé de tuyaux d'orgue, qui diminuent du côté de la hypothénuse.
L'enfant arrange les tiges qui ont d'abord été éparpillées et mélangées. Il les assemble selon la graduation de longueur et observe la correspondance des couleurs. Cet exercice offre également un contrôle d'erreur très évident, car la régularité de la longueur décroissante de l'escalier le long de l'hypothénuse sera altérée si les tiges ne sont pas correctement placées.
Cet ensemble de blocs le plus important aura sa principale application en arithmétique, comme nous le verrons. Avec lui, on peut compter de un à dix et on peut construire l'addition et d'autres tables, et il peut constituer les premiers pas dans l'étude du système décimal et métrique.
* ( *c*) Taille : Objets, plus grands et plus petits : Cet ensemble est composé de dix cubes en bois peints en émail de couleur rose. Le plus grand cube a une base de 10 centimètres, le plus petit, de 1 centimètre, et les intermédiaires diminuent de 1 centimètre chacun. Un petit tapis de drap vert accompagne ces blocs. Celui-ci peut être en toile cirée ou en carton. Le jeu consiste à empiler les cubes les uns sur les autres, dans l'ordre de leurs dimensions, en construisant une petite tour dont le plus gros cube forme la base et le plus petit le sommet. Le tapis est placé sur le sol et les cubes sont éparpillés dessus. Au fur et à mesure que la tour est construite sur le tapis, l'enfant passe par l'exercice de s'agenouiller, de se lever, etc. Le contrôle est donné par l'irrégularité de la tour à mesure qu'elle diminue vers le sommet. Un cube mal placé se révèle car il casse la ligne. L'erreur la plus courante commise par les enfants en jouant avec ces blocs au début est de placer le deuxième cube comme base et de placer le premier cube dessus, confondant ainsi les deux plus grands blocs. J'ai constaté que la même erreur était commise par des enfants déficients dans les essais répétés que j'ai faits avec les tests de De Sanctis. A la question "Quel est le plus grand ?" l'enfant prendrait, non pas le plus gros, mais celui qui s'en approche le plus.
N'importe lequel de ces trois ensembles de blocs peut être utilisé par les enfants dans un jeu légèrement différent. Les pièces peuvent être mélangées sur un tapis ou une table, puis mises en ordre sur une autre table à une certaine distance. Au fur et à mesure qu'il porte chaque pièce, l'enfant doit marcher sans laisser vagabonder son attention, puisqu'il doit se souvenir des dimensions de la pièce qu'il doit chercher parmi les blocs mélangés.
Les jeux ainsi pratiqués sont excellents pour les enfants de quatre ou cinq ans ; tandis que le simple travail d'arrangement des pièces sur le même tapis où elles ont été mélangées est plus adapté aux petits entre trois et quatre ans. La construction de la tour avec les cubes roses est très attrayante pour les petits de moins de trois ans, qui la démontent et la construisent à chaque fois.
**
> **Quelques-uns des nombreux inserts géométriques en bois utilisés pour enseigner la forme**
 Incrustations géométriques de bois et de cadre. Le cadre fournit le contrôle nécessaire à l'exactitude du travail. (B) Armoire. (Pour stocker des cadres d'encart géométriques.)")
> **(A) Incrustations géométriques de bois et de cadre. Le cadre fournit le contrôle nécessaire à l'exactitude du travail.\
> (B) Armoire. (Pour stocker des cadres d'encart géométriques.)**
***II. Perception visuelle différentielle de la forme et perception visuelle-tactile-musculaire***
***Matériel didactique** .* Incrustations géométriques ***planes de bois :*** L'idée de ces incrustations remonte à Itard et a également été appliquée par Séguin.
A l'école des déficients, j'avais fait et appliqué ces incrustations sous la même forme que celle utilisée par mes illustres prédécesseurs. Dans ceux-ci, il y avait deux grandes tablettes de bois placées l'une au-dessus de l'autre et attachées ensemble. La planche inférieure a été laissée pleine, tandis que la planche supérieure a été perforée de diverses figures géométriques. Le jeu consistait à placer dans ces ouvertures les figurines de bois correspondantes qui, pour être facilement manipulables, étaient munies d'un petit bouton de laiton.
Dans mon école pour débiles, j'ai multiplié les jeux faisant appel à ces encarts et distinguais ceux qui servaient à enseigner la couleur et ceux qui servaient à enseigner la forme. Les encarts pour enseigner la couleur étaient tous des cercles, et ceux utilisés pour enseigner la forme étaient tous peints en bleu. J'ai fait faire un grand nombre de ces incrustations dans des graduations de couleur et dans une infinie variété de formes. Ce matériel était le plus cher et extrêmement encombrant.
Dans de nombreuses expériences ultérieures avec des enfants normaux, j'ai, après de nombreux essais, complètement exclu les incrustations géométriques planes comme aide à l'enseignement de la couleur, car ce matériel n'offre aucun contrôle des erreurs, la tâche de l'enfant étant de ***couvrir*** les formes devant lui . .
J'ai conservé les incrustations géométriques, mais leur ai donné un aspect nouveau et original. La forme dans laquelle ils sont maintenant faits m'a été suggérée par une visite à la splendide école de formation manuelle de la maison de correction Saint-Michel à Rome. J'y ai vu des modèles en bois de figures géométriques, qui pouvaient être placés dans des cadres correspondants ou placés au-dessus de formes correspondantes. La portée de ces matériaux devait conduire à l'exactitude dans la fabrication des pièces géométriques en ce qui concerne le contrôle de la dimension et de la forme; le ***cadre*** fournissant le ***contrôle*** nécessaire à l'exactitude du travail.
Cela m'a amené à penser à apporter des modifications à mes incrustations géométriques, en utilisant à la fois le cadre et l'incrustation. J'ai donc fait un plateau rectangulaire, qui mesurait 30x20 centimètres. Ce plateau était peint en bleu foncé et était entouré d'un cadre sombre. Il était garni d'une couverture disposée de manière à contenir six des cadres carrés avec leurs encarts. L'avantage de ce plateau est que les formes peuvent être changées, nous permettant ainsi de présenter n'importe quelle combinaison que nous choisissons. J'ai un certain nombre de carrés de bois vierges qui permettent de présenter aussi peu que deux ou trois formes géométriques à la fois, les autres espaces étant remplis par les blancs. A ce matériel, j'ai ajouté un jeu de cartes blanches, de 10 centimètres carrés. Ces cartes forment une série présentant les formes géométriques sous d'autres aspects. Dans le ***premier*** de la série, le formulaire est découpé dans du papier bleu et monté sur la carte. Dans la ***deuxième*** boîte de cartes, le ***contour*** des mêmes figures est monté sur le même papier bleu, formant un contour d'un centimètre de largeur. Sur le ***troisième*** jeu de cartes, le contour de la forme géométrique est ***délimité par un trait noir** .* Nous avons ensuite le plateau, la collection de petits cadres avec leurs encarts correspondants, et le jeu des cartes en trois séries.
J'ai également conçu une mallette contenant six plateaux. Le devant

> **Certains des formulaires de cartes utilisés dans les exercices avec les trois séries de cartes.**
## [13.5 Exercices avec les trois séries de cartes](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapter+13+-+Education+of+the+senses+and+illustrations+of+the+didactic+material%3A+General+sensibility%3A+The+tactile%2C+thermic%2C+basic%2C+and+stereo+gnostic+senses#13.5-exercises-with-the-three-series-of-cards 'Lien vers le texte de base de traduction de Montessori.Zone "La méthode Montessori"')
Cette boîte peut être abaissée lorsque le plateau est relevé et les plateaux peuvent être retirés comme on ouvre les tiroirs d'un bureau. Chaque tiroir contient six petits cadres avec leurs encarts respectifs. Dans le premier tiroir, je garde les quatre carrés en bois brut et deux cadres, l'un contenant un rhomboïde, et l'autre un trapèze. Dans le second, j'ai une série composée d'un carré et de cinq rectangles de même longueur, mais de largeur variable. Le troisième tiroir contient six cercles qui diminuent de diamètre. Dans le quatrième se trouvent six triangles, dans le cinquième, cinq polygones allant d'un pentagone à un décagone. Le sixième tiroir contient six figures courbes (une ellipse, un ovale, etc., et une figure en forme de fleur formée de quatre arcs croisés).
***Exercice avec les encarts** .* Cet exercice consiste à présenter à l'enfant le grand cadre ou plateau dans lequel on pourra disposer les figures comme on veut les présenter. On procède au retrait des inserts, on les mélange sur la table, puis on invite l'enfant à les remettre en place. Ce jeu peut être joué même par les plus jeunes enfants et retient l'attention pendant une longue période, mais pas aussi longtemps que l'exercice avec les cylindres. En effet, je n'ai jamais vu un enfant répéter cet exercice plus de cinq ou six fois. L'enfant, en effet, dépense beaucoup d'énergie dans cet exercice. Il doit ***reconnaître*** la forme et doit la regarder attentivement.
Au début, beaucoup d'enfants ne réussissent à placer les encarts qu'après de nombreuses tentatives, essayant par exemple de placer un triangle dans un trapèze, puis dans un rectangle, etc. Ou lorsqu'ils ont pris un rectangle et reconnu où il doit aller, ils vont placez-le toujours avec le côté long de l'encart sur le côté court de l'ouverture, et ne réussira qu'après de nombreuses tentatives à le placer. ***Après trois ou quatre leçons successives, l'enfant reconnaît avec une extrême*** facilité les figures riches en géométrie et place les encarts avec une sécurité teintée de nonchalance, ou de ***léger mépris pour un exercice trop facile .** .* C'est le moment où l'enfant peut être amené à une observation méthodique des formes. On change les formes dans le cadre et on passe de cadres contrastés à des cadres analogues. L'exercice est facile pour l'enfant, qui s'habitue à placer les pièces dans leurs cadres sans erreur ni fausse tentative.
La première période de ces exercices est au moment où l'enfant est obligé de faire des ***essais*** répétés avec des figures fortement contrastées dans la forme. La ***reconnaissance*** est grandement aidée en associant au sens visuel la perception musculo-tactile des formes. Je fais toucher [\*](https://digital.library.upenn.edu/women/montessori/method/method-XIII.html#198-1) à l'enfant le contour de la pièce avec l' ***index*** de ***la main droite** ,* puis je lui fais répéter cela avec le contour du cadre dans lequel les pièces doivent s'emboîter. Nous réussissons à en faire une ***habitude*** avec l'enfant. Ceci est très facile à atteindre car tous les enfants aiment toucher les choses. J'ai déjà appris, par mon travail avec des enfants déficients, que parmi les diverses formes de mémoire sensorielle, le sens musculaire est le plus précoce. En effet, beaucoup d'enfants qui ne sont pas arrivés au point de reconnaître une ***figure en la regardant*** pourraient la reconnaître en la ***touchant** ,* c'est-à-dire en calculant les mouvements nécessaires au suivi de son contour. Il en est de même de la plupart des enfants normaux, confus quant à l'endroit où placer une figure, ils la tournent en essayant en vain de l'insérer, mais dès qu'ils ont touché les deux contours de la pièce et de son cadre, ils réussir à le placer parfaitement. Sans doute, l'association du sens musculo-tactile avec celui des aides visuelles de la manière la plus remarquable dans la perception des formes et les fixe dans la mémoire.
> \* Ici et ailleurs dans le livre, le mot "toucher" est utilisé non seulement pour exprimer le contact entre les doigts et un objet, mais le mouvement des doigts ou des mains sur un objet ou son contour.
Dans de tels exercices, le contrôle est absolu, comme il l'était dans les encarts pleins. Le chiffre ne peut entrer que dans le cadre correspondant. Cela permet à l'enfant de travailler par lui-même, et d'accomplir une véritable auto-éducation sensorielle, dans la perception visuelle de la forme.
***Exercice avec les trois séries de cartes. Première série.*** Nous donnons à l'enfant les formes en bois et les cartes sur lesquelles la figure blanche est montée. Puis nous mélangeons les cartes sur la table ; l'enfant doit les disposer en ligne sur sa table (ce qu'il aime à faire), puis placer les pièces de bois correspondantes sur les cartes. Ici, le contrôle réside dans les yeux. L'enfant doit ***reconnaître*** cette figure et y placer la pièce de bois si parfaitement qu'elle couvrira et cachera la figure de papier. L'œil de l'enfant correspond ici au cadre, ce qui ***l'a conduit matériellement*** dans un premier temps à rapprocher les deux pièces. En plus de couvrir la silhouette, l'enfant doit s'habituer à ***toucher*** le contour des figures montées dans le cadre de l'exercice (l'enfant suit toujours volontairement ces mouvements); et après avoir placé l'insert en bois, il touche à nouveau le contour, ajustant avec son doigt la pièce superposée jusqu'à ce qu'elle recouvre exactement la forme en dessous.
***Deuxième série** .* Nous donnons un certain nombre de cartes à l'enfant avec les encarts en bois correspondants. Dans cette deuxième série, les figures sont répétées par un contour de papier bleu. L'enfant à travers ces exercices passe progressivement du ***concret*** à l' ***abstrait** .* Au début, il ne manipulait que ***des objets solides** .* Il passa alors à une ***figure plane** ,* c'est-à-dire au plan qui en soi n'existe pas. Il passe maintenant à la ***ligne** ,* mais cette ligne ne représente pas pour lui le contour abstrait d'une figure plane. C'est pour lui le ***chemin qu'il a si souvent suivi avec son index*** cette ligne est le ***trace d'un mouvement** .* En suivant à nouveau le contour de la figure avec son doigt, l'enfant a l'impression de laisser réellement une trace, car la figure est recouverte par son doigt et apparaît au fur et à mesure qu'il le déplace. C'est maintenant l'œil qui guide le mouvement, mais il faut se rappeler que ce mouvement était ***déjà préparé*** lorsque l'enfant toucha les contours des morceaux de bois massifs.
***Troisième série** .* Nous présentons maintenant à l'enfant les cartes sur lesquelles les figures sont dessinées en noir, en lui donnant, comme précédemment, les pièces de bois correspondantes. Ici, il est effectivement passé à la ***ligne*** , c'est-à-dire à l'abstraction, mais là aussi, il y a l'idée du résultat d'un mouvement.
Ce ne peut être, il est vrai, la trace laissée par le doigt, mais, par exemple, celle d'un crayon qui est guidé par la main dans les mêmes mouvements effectués auparavant. Ces figures géométriques aux contours simples ***sont issues*** d'une série progressive de représentations concrètes à la vue et au toucher. Ces représentations reviennent à l'esprit de l'enfant lorsqu'il effectue l'exercice de superposition des figures de bois correspondantes.
## [13.6 Education du sens chromatique](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapter+13+-+Education+of+the+senses+and+illustrations+of+the+didactic+material%3A+General+sensibility%3A+The+tactile%2C+thermic%2C+basic%2C+and+stereo+gnostic+senses#13.6-education-of-the-chromatic-sense 'Lien vers le texte de base de traduction de Montessori.Zone "La méthode Montessori"')
***III. Perception visuelle différentielle des contours : éducation du sens chromatique***
Dans beaucoup de nos ***leçons sur les couleurs** ,* nous nous servons de morceaux d'étoffe de couleurs vives et de pelotes recouvertes de laine de différentes couleurs. Le matériel didactique pour l' ***enseignement du chromatique*** sens est le suivant, que j'ai établi après une longue série d'essais faits sur des enfants normaux, (dans l'institut des déficients, j'ai utilisé, comme je l'ai dit plus haut, les inserts géométriques. Le matériel actuel se compose de petits comprimés plats, qui sont enroulées avec de la laine ou de la soie de couleur. Ces tablettes ont à chaque extrémité une petite bordure en bois qui empêche la carte recouverte de soie de toucher la table. On apprend aussi à l'enfant à saisir la pièce par ces extrémités en bois afin qu'il n'ait pas besoin de la salir. les couleurs [délicates.De](http://xn--dlicates-b1a.De) cette façon, nous sommes en mesure d'utiliser ce matériau pendant longtemps sans avoir à le renouveler.
 Laçage (B) Boutonnage de chaussures (C) Boutonnage d'autres vêtements (D) Agrafes et œillets")
> **(A) Laçage\
> (B) Boutonnage de chaussures\
> (C) Boutonnage d'autres vêtements\
> (D) Agrafes et œillets**
>
> **Des cadres illustrent les différents processus d'habillage et de déshabillage.**

> **Les tablettes sont enroulées avec de la soie colorée. Utilisé pour éduquer le sens chromatique. Les comprimés sont présentés dans les boîtes dans lesquelles ils sont conservés.**
J'ai choisi huit teintes et chacune comporte huit dégradés d'intensités de couleurs différentes. Il y a donc soixante-quatre tablettes de couleur en tout. Les huit teintes sélectionnées sont *le noir **(du gris au blanc), le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet*** et ***le marron** .* Nous avons des boîtes en double de ces soixante-quatre couleurs, nous donnant deux de chaque exercice. L'ensemble complet se compose donc de cent vingt-huit tablettes. Ils sont contenus dans deux boîtes, chacune divisée en huit compartiments égaux, de sorte qu'une boîte peut contenir soixante-quatre comprimés.
***Exercices avec les Color-tablets** .* Pour le premier de ces exercices, nous sélectionnons trois couleurs fortes : par exemple, ***le rouge, le bleu*** et ***le jaune*** , par paires. Ces six tablettes, nous les plaçons sur la table devant l'enfant. Lui montrant une des couleurs, nous lui demandons de trouver son double parmi les tablettes mélangées sur la table. De cette manière, nous lui faisons disposer les tablettes de couleur en colonne, deux par deux, en les appariant selon la couleur.
Le nombre de tablettes dans ce jeu peut être augmenté jusqu'à ce que les huit couleurs, ou seize tablettes, soient données en une seule fois. Lorsque les tons les plus forts ont été présentés, on peut procéder à la présentation des tons plus clairs, de la même manière. Enfin, nous présentons deux ou trois tablettes de la même couleur, mais d'un ton différent, montrant à l'enfant comment les disposer par ordre de gradation. De cette façon, les huit gradations sont enfin présentées.
Ensuite, on place devant l'enfant les huit dégradés de deux couleurs différentes (rouge et bleu) ; on lui montre comment séparer les groupes puis organiser chaque groupe en gradation. Au fur et à mesure que nous procédons, nous proposons des groupes de couleurs plus proches; par exemple, bleu et violet, jaune et orange, etc.
Dans l'une des "maisons des enfants", j'ai vu jouer le jeu suivant avec le plus grand succès et le plus grand intérêt, et avec une ***rapidité** surprenante .* La directrice place sur une table autour de laquelle sont assis les enfants autant de groupes de couleurs qu'il y a d'enfants, par exemple trois. Elle attire ensuite l'attention de chaque enfant sur la couleur que chacun doit choisir ou qu'elle lui attribue. Ensuite, elle mélange les trois groupes de couleurs sur la table. Chaque enfant prend rapidement du tas de tablettes mélangées toutes les nuances de sa couleur et procède à la disposition des tablettes qui, ainsi disposées en ligne, donnent l'apparence d'une bande de ruban nuancé.
Dans une autre « maison », j'ai vu les enfants prendre la boîte entière, vider les soixante-quatre tablettes de couleur sur la table, et après les avoir soigneusement mélangées, les rassembler rapidement en groupes et les disposer en gradation, construisant une espèce de petit tapis. de teintes délicatement colorées et entremêlées. Les enfants acquièrent très vite une capacité devant laquelle on reste émerveillé. Les enfants de trois ans sont capables de mettre toutes les teintes en dégradé.
***Expériences en mémoire de couleur** .* Des expériences de mémoire des couleurs peuvent être faites en montrant à l'enfant une teinte, en lui permettant de la regarder aussi longtemps qu'il le voudra, puis en lui demandant d'aller à une table éloignée sur laquelle toutes les couleurs sont disposées et de choisir parmi leur la teinte semblable à celle qu'il a regardée. Les enfants réussissent remarquablement bien à ce jeu, ne commettant que de légères erreurs. Les enfants de cinq ans s'en amusent énormément, prenant beaucoup de plaisir à comparer les deux bobines et à juger s'ils ont bien choisi.
At the beginning of my work, I made use of an instrument invented by Pizzoli. This consisted of a small brown disk having a half-moon shape opening at the top. Various colors were made to pass behind this opening, by means of a rotary disk which was composed of strips of various colors. The teacher called the attention of the child to a certain color, then turned the disk, asking him to indicate the same disk when it again showed itself in the opening. This exercise rendered the child inactive, preventing him from controlling the material. It is not, therefore, an instrument that can promote the ***education*** of the senses.
## [13.7 Exercise for the discrimination of sounds](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapter+13+-+Education+of+the+senses+and+illustrations+of+the+didactic+material%3A+General+sensibility%3A+The+tactile%2C+thermic%2C+basic%2C+and+stereo+gnostic+senses#13.7-exercise-for-the-discrimination-of-sounds 'Lien vers le texte de base de traduction de Montessori.Zone "La méthode Montessori"')
Il serait souhaitable de disposer à cet égard du matériel didactique utilisé pour "l'éducation auriculaire" dans les principales institutions pour sourds-muets d'Allemagne et d'Amérique. Ces exercices sont une introduction à l'acquisition du langage et servent d'une manière toute particulière à centrer l'attention discriminative des enfants sur les « modulations du son de la voix humaine ».
Chez les très jeunes enfants, l'éducation linguistique doit occuper une place des plus importantes. Un autre but de tels exercices est d'éduquer l'oreille de l'enfant aux bruits afin qu'il s'habitue à distinguer tout bruit léger et à le comparer avec des ***sons*** , venant à détester les bruits durs ou désordonnés. Une telle éducation des sens a de la valeur en ce qu'elle exerce le goût esthétique et peut être appliquée d'une manière remarquable à la pratique de la discipline. Nous savons tous comment les plus jeunes enfants troublent l'ordre de la salle par des cris et le bruit d'objets renversés.
L'éducation scientifique rigoureuse de l'ouïe n'est pratiquement pas applicable à la méthode didactique. Cela est vrai parce que l'enfant ne peut pas ***s'exercer par sa propre activité*** comme il le fait pour les autres sens. Un seul enfant à la fois peut travailler avec n'importe quel instrument produisant la gradation des sons. En d'autres termes, ***le silence absolu*** est nécessaire à la discrimination des sons.
Signorina Maccheroni, directrice, d'abord de la "Maison des enfants" à Milan et plus tard dans celle du couvent franciscain à Rome, a inventé et fait fabriquer une série de treize cloches accrochées à un cadre en bois. Ces cloches sont en apparence identiques, mais les vibrations provoquées par un coup de marteau produisent les treize notes suivantes :

L'ensemble se compose d'une double série de treize cloches et de quatre marteaux. Après avoir frappé l'une des cloches de la première série, l'enfant doit trouver le son correspondant dans la seconde. Cet exercice présente une grande difficulté, car l'enfant ne sait pas frapper à chaque fois avec la même force, et produit donc des sons plus ou moins intenses. Même lorsque le professeur frappe les cloches, les enfants ont du mal à distinguer les sons. Nous ne pensons donc pas que cet instrument, dans sa forme actuelle, soit entièrement pratique.
Pour la discrimination des sons, nous utilisons la série de petits sifflets de Pizzoli. Pour la gradation des bruits, on utilise de petites boîtes remplies de différentes substances, plus ou moins fines (sable ou cailloux). Les bruits sont produits en secouant les boîtes.
Dans les leçons pour l'ouïe, je procède comme suit : je fais établir le silence de la manière habituelle par les professeurs, puis je ***continue*** le travail en rendant le silence plus profond. Je dis, "St! St!" dans une série de modulations, tantôt aiguës et courtes, tantôt prolongées et légères comme un murmure. Les enfants, petit à petit, en deviennent fascinés. De temps à autre, je dis : « Encore plus silencieux, plus silencieux.
Je commence alors le St sifflant ! St! encore une fois, le rendant toujours plus léger et répétant "Plus silencieux encore", dans un murmure à peine audible, "Maintenant, j'entends l'horloge, maintenant j'entends le bourdonnement des ailes d'une mouche, maintenant j'entends le murmure des arbres dans le jardin."
Les enfants, extatiques de joie, sont assis dans un silence si absolu et complet que la salle semble déserte ; puis je murmure : "Fermons les yeux." Cet exercice répété habitue tellement les enfants à l'immobilité et au silence absolu que, lorsque l'un d'eux interrompt, il suffit d'une syllabe, d'un geste pour le rappeler immédiatement à l'ordre parfait.
Dans le silence, nous procédions à la production de sons et de bruits, les rendant d'abord fortement contrastés, puis plus proches. Parfois, nous présentons les comparaisons entre le bruit et le son. Je crois que les meilleurs résultats peuvent être obtenus avec les moyens primitifs employés par Itard en 1805. Il utilisait le tambour et la cloche. Son projet était une série graduée de tambours pour les bruits, ou mieux, pour les sons harmoniques lourds, puisque ceux-ci appartiennent à un instrument de musique, et une série de cloches. Le diapason, les sifflets et les boîtes n'attirent pas l'enfant et n'éduquent pas l'ouïe comme le font ces autres instruments. Il y a une suggestion intéressante dans le fait que les deux grandes institutions humaines, celle de la haine (guerre) et celle de l'amour (religion), ont adopté ces deux instruments opposés, le tambour et la cloche.
Je crois qu'après avoir établi le silence, il serait éducatif de faire sonner des cloches bien sonores, tantôt calmes et douces, tantôt claires et sonnantes, envoyant leurs vibrations dans tout le corps de l'enfant. Et quand, en plus de l'éducation de l'oreille, on a produit une éducation ***vibratoire*** de l'oreille, on a produit une éducation ***vibratoire*** de tout le corps, à travers ces sons judicieusement choisis des cloches, donnant une paix qui imprègne les fibres mêmes de son étant, alors je crois que ces jeunes corps seraient sensibles aux bruits grossiers, et les enfants en viendraient à détester, et à cesser de faire des bruits désordonnés et laids.
Ainsi, celui dont l'oreille a été formée par une éducation musicale souffre de notes stridentes ou discordantes. Je n'ai pas besoin de donner d'illustration pour faire comprendre l'importance d'une telle éducation pour les masses dans l'enfance. La nouvelle génération serait plus calme, se détournant de la confusion et des sons discordants, qui frappent l'oreille aujourd'hui dans l'un des vils immeubles où la vie pauvre, entassée, laissée par nous pour s'abandonner aux instincts humains inférieurs et plus brutaux .
## [13.8 Éducation musicale](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapter+13+-+Education+of+the+senses+and+illustrations+of+the+didactic+material%3A+General+sensibility%3A+The+tactile%2C+thermic%2C+basic%2C+and+stereo+gnostic+senses#13.8-musical-education 'Lien vers le texte de base de traduction de Montessori.Zone "La méthode Montessori"')
Cela doit être soigneusement guidé par une méthode. En général, on voit passer de petits enfants devant le jeu de quelques grands musiciens comme passerait un animal. Ils ne perçoivent pas la délicate complexité des sons. Les enfants des rues se rassemblent autour du joueur d'orgue de barbarie, criant comme pour saluer de joie les ***bruits*** qui viendront à la place des sons.
Pour l'éducation musicale, il faut ***créer des instruments*** en plus de la musique. La portée d'un tel instrument, en plus de la discrimination des sons, est d'éveiller le sens du rythme et, pour ainsi dire, de donner l' ***impulsion*** vers des mouvements calmes et coordonnés à ces muscles qui vibrent déjà dans la paix et la tranquillité de l'immobilité.
Je crois que les instruments à cordes (peut-être une harpe très simplifiée) seraient les plus pratiques. Les instruments à cordes avec le tambour et les cloches forment le trio des instruments classiques de l'humanité. La harpe est l'instrument de « la vie intime de l'individu ». La légende le place entre les mains d'Orphée, le folklore le met entre les mains des fées et la romance le donne à la princesse qui conquiert le cœur d'un prince méchant.
L'enseignante qui tourne le dos à ses élèves pour jouer, (bien trop souvent mal), ne sera jamais l' ***éducatrice*** de leur sens musical.
L'enfant a besoin d'être charmé en tout point, par le regard comme par la pose. La maîtresse qui, se penchant vers eux, les rassemblant autour d'elle, et les laissant libres de rester ou de partir, touche les accords, dans un rythme simple, se met en communication avec eux, ***en rapport avec leur âme même** .* Tant mieux si ce toucher peut être accompagné de sa voix, et les enfants laissés libres de la suivre, personne n'étant obligé de chanter. De cette façon, elle peut sélectionner comme « adaptées à l'éducation », les chansons qui ont été suivies par tous les enfants. Ainsi, elle peut régler la complexité du rythme aux différents âges, car elle ne verra plus que les grands enfants suivre le rythme, maintenant aussi les petits. En tout cas, je crois que les instruments simples et primitifs sont les mieux adaptés à l'éveil de la musique dans l'âme du petit enfant.
J'ai essayé de faire faire à la directrice de la "Maison des enfants" de Milan, qui est une musicienne douée, un certain nombre d'essais et d'expériences, en vue d'en savoir plus sur la capacité musculaire des jeunes enfants. Elle a fait de nombreux essais avec le pianoforte, observant comment les enfants ***ne sont pas sensibles au ton*** musical , mais seulement au ***rythme** .* Sur la base du rythme, elle arrangeait de petites danses simples, dans le but d'étudier l'influence du rythme lui-même sur la coordination des mouvements musculaires. Elle a été très surprise de découvrir l' effet ***disciplinaire éducatif*** d'une telle musique. Ses enfants, qui avaient été conduits avec beaucoup de sagesse et d'art par la liberté à une ***spontanéité*** ordonnant leurs actes et leurs mouvements, avait pourtant vécu dans les rues et les cours et avait l'habitude presque universelle de sauter.
Adepte fidèle de la méthode de la liberté, et ne considérant pas que ***sauter*** était un acte répréhensible, elle ne les avait jamais corrigés.
Elle remarqua alors qu'au fur et à mesure qu'elle multipliait et répétait les exercices de rythme, les enfants cessaient peu à peu leurs vilains sauts, jusqu'à ce que finalement, cela appartienne au passé. La directrice demanda un jour des explications à ce changement de conduite. Plusieurs petits la regardaient sans rien dire. Les enfants plus âgés donnaient diverses réponses, dont le sens était le même.
* "Ce n'est pas agréable de sauter."
* "Sauter c'est moche."
* "C'est impoli de sauter."
Ce fut certainement un beau triomphe pour notre méthode !
Cette expérience montre qu'il est possible d'éduquer le ***sens musculaire*** de l'enfant , et elle montre combien le raffinement de ce sens peut être exquis lorsqu'il se développe en relation avec la ***mémoire musculaire*** , et à côté des autres formes de mémoire sensorielle.
## [13.9 Tests d'acuité auditive](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapter+13+-+Education+of+the+senses+and+illustrations+of+the+didactic+material%3A+General+sensibility%3A+The+tactile%2C+thermic%2C+basic%2C+and+stereo+gnostic+senses#13.9-tests-for-acuteness-of-hearing 'Lien vers le texte de base de traduction de Montessori.Zone "La méthode Montessori"')
Les seules expériences entièrement réussies que nous ayons faites jusqu'ici dans les « Maisons d'Enfants » sont celles de l' ***horloge*** , et de la ***voix abaissée*** ou chuchotée *.* L'essai est purement empirique et ne se prête pas à la mesure de la sensation, mais il est cependant très utile en ce qu'il nous aide à une connaissance approximative de l'acuité auditive de l'enfant.
L'exercice consiste à attirer l'attention, une fois le silence parfait établi, sur le tic-tac de l'horloge et sur tous les petits bruits qui ne sont pas communément audibles à l'oreille. Enfin, nous appelons les petits, un par un depuis une pièce voisine, en prononçant chaque nom à voix basse. En se préparant à un tel exercice, il est nécessaire d' ***enseigner*** aux enfants le vrai sens du ***silence** .*
A cette fin, j'ai plusieurs ***jeux de silence*** , qui aident de manière surprenante à renforcer la remarquable discipline de nos enfants.
J'attire l'attention des enfants sur moi, leur disant de voir à quel point je peux me taire. J'assume différentes positions; debout, assis et en maintenant chaque pose ***en silence, sans mouvement** .* Un doigt qui bouge peut produire du bruit, même s'il est imperceptible. Nous pouvons respirer pour être entendus. Mais je garde un silence ***absolu*** , ce qui n'est pas chose aisée. J'appelle un enfant et lui demande de faire comme moi. Il ajuste ses pieds dans une meilleure position, et cela fait du bruit ! Il remue un bras en l'étendant sur le bras de sa chaise ; c'est un bruit. Sa respiration n'est pas tout à fait silencieuse, elle n'est pas tranquille, absolument inouïe comme la mienne.
Pendant ces manœuvres de la part de l'enfant, et tandis que mes brefs commentaires sont suivis d'intervalles d'immobilité et de silence, les autres enfants regardent et écoutent. Beaucoup d'entre eux sont intéressés par le fait, qu'ils n'ont jamais remarqué auparavant ; à savoir que nous faisons tant de bruits dont nous n'avons pas conscience, et qu'il y a des ***degrés*** de ***silence** .* Il y a un silence absolu où rien, ***absolument rien*** se déplace. Ils me regardent avec étonnement lorsque je me tiens au milieu de la pièce, si silencieusement que c'est vraiment comme si « je n'étais pas ». Ensuite, ils s'efforcent de m'imiter et de faire encore mieux. J'attire l'attention ici et là sur un pied qui bouge, presque par inadvertance. L'attention de l'enfant est appelée sur chaque partie de son corps dans un désir anxieux d'atteindre l'immobilité.
Lorsque les enfants essaient ainsi, il s'établit un silence bien différent de celui que nous appelons négligemment de ce nom.
Il semble que la vie s'évanouisse peu à peu, et que la pièce se vide peu à peu comme s'il n'y avait plus personne dedans. Puis nous commençons à entendre le tic-tac de l'horloge, et ce son semble croître en intensité à mesure que le silence devient absolu. Du dehors, de la cour qui auparavant paraissait silencieuse, viennent des bruits variés, un oiseau gazouille, un enfant passe. Les enfants sont assis, fascinés par ce silence, comme s'il s'agissait de leur propre conquête. « Ici, dit la directrice, ici il n'y a plus personne, les enfants sont tous partis.
Arrivés à ce point, nous assombrissons les fenêtres et disons aux enfants de fermer les yeux, en posant leur tête sur leurs mains. Ils prennent cette position, et dans l'obscurité, le silence absolu revient.
« Maintenant, écoutez », disons-nous. "Une voix douce va appeler votre nom." Puis, allant dans une chambre derrière les enfants, et debout derrière la porte ouverte, j'appelle à voix basse, m'attardant sur les syllabes comme si j'appelais de l'autre côté des montagnes. Cette voix, presque occulte, semble atteindre le cœur et appeler l'âme de l'enfant. Chacun, comme on l'appelle, lève la tête, ouvre les yeux comme tout à fait heureux, puis se lève en cherchant silencieusement à ne pas bouger la chaise, et marche sur la pointe des pieds, si doucement qu'on l'entend à peine. Pourtant, son pas résonne dans le silence, au milieu de l'immobilité qui persiste.
Arrivé à la porte, le visage joyeux, il se précipite dans la pièce en étouffant de doux éclats de rire. Un autre enfant viendra peut-être cacher son visage contre ma robe, un autre, se retournant, regardera ses compagnons assis comme des statues, silencieux et attendant. Celui qui est appelé se sent privilégié, qu'il a reçu un don, un prix. Et pourtant ils savent que tous seront appelés, « en commençant par le plus silencieux de la pièce ». Alors chacun essaie de mériter par son silence parfait l'appel certain. J'ai vu une fois un petit de trois ans essayer d'étouffer un éternuement, et réussir ! Elle retint son souffle dans son petit sein, et résista, en sortant victorieuse. Un effort des plus surprenants !
Ce jeu ravit les plus petits au-delà de toute mesure. Leurs visages attentifs et leur immobilité patiente révèlent la jouissance d'un grand plaisir. Au début, quand l'âme de l'enfant m'était inconnue, j'avais pensé à lui montrer des friandises et des petits jouets, en promettant de les donner à ceux qu'on ***appellerait*** , supposant que les cadeaux seraient nécessaires pour persuader l'enfant de faire l'effort nécessaire. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas nécessaire.
Les enfants, après avoir fait l'effort nécessaire pour garder le silence, jouissaient de la sensation et prenaient plaisir au ***silence*** lui-même. Ils étaient comme des navires en sécurité dans un port tranquille, heureux d'avoir vécu quelque chose de nouveau et d'avoir remporté une victoire sur eux-mêmes. C'était en effet leur récompense. Ils ont ***oublié*** la promesse de sucreries et ne se sont plus souciés de prendre les jouets, dont j'avais supposé qu'ils les attireraient. J'ai donc abandonné ce moyen inutile, et j'ai vu, avec surprise, que le jeu devenait de plus en plus parfait jusqu'à ce que même des enfants de trois ans restaient immobiles dans le silence pendant tout le temps nécessaire pour appeler les quarante enfants au complet hors de la pièce !
C'est alors que j'ai appris que l'âme de l'enfant a sa propre récompense et ses plaisirs spirituels particuliers. Après de tels exercices, il m'a semblé que les enfants se sont rapprochés de moi, certainement, ils sont devenus plus obéissants, plus doux et plus doux. Nous avions, en effet, été isolés du monde, et avions passé plusieurs minutes pendant lesquelles la communion entre nous était très étroite, je les souhaitais et les appelais, et ils recevaient dans le silence parfait la voix qui s'adressait personnellement à chacun l'un d'eux, les couronnant tour à tour de bonheur.
## [13.10 Une leçon en silence](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapter+13+-+Education+of+the+senses+and+illustrations+of+the+didactic+material%3A+General+sensibility%3A+The+tactile%2C+thermic%2C+basic%2C+and+stereo+gnostic+senses#13.10-a-lesson-in-silence 'Lien vers le texte de base de traduction de Montessori.Zone "La méthode Montessori"')
Je suis sur le point de décrire une leçon qui ***s'est avérée*** la plus efficace pour enseigner le silence parfait auquel il est possible d'atteindre. Un jour que j'allais entrer dans une des « Maisons des Enfants », je rencontrai dans la cour une mère qui tenait dans ses bras son petit bébé de quatre mois. Le petit était emmailloté, comme c'est encore la coutume parmi le peuple de Rome, un enfant ainsi dans les bandes d'emmaillotage est appelé par nous une ***chrysalide** .* Ce petit tranquille semblait l'incarnation de la paix. Je l'ai prise dans mes bras, où elle était tranquille et bonne. La tenant toujours, je me dirigeai vers la salle de classe, d'où les enfants couraient maintenant à ma rencontre. Elles m'accueillaient toujours ainsi, me jetant leurs bras autour de moi, s'accrochant à mes jupes, et me renversant presque dans leur empressement. Je leur ai souri,***pupe.*** « Ils ont compris et sautillé autour de moi en me regardant avec des yeux brillants de plaisir, mais ne m'ont pas touché par respect pour le petit que je tenais dans mes bras.
Je suis entré dans la salle de classe avec les enfants groupés autour de moi. Nous nous sommes assis, je me suis assis dans un grand fauteuil au lieu, comme d'habitude, d'un de leurs petits fauteuils. En d'autres termes, je me suis assis solennellement. Ils ont regardé mon petit avec un mélange de tendresse et de joie. Aucun de nous n'avait encore prononcé un mot. Finalement, je leur ai dit : « Je vous ai amené un petit professeur. Regards et rires surpris. « Une petite maîtresse, oui, car aucun de vous ne sait se taire comme elle. À cela, tous les enfants ont changé de position et sont devenus silencieux. "Pourtant, personne ne tient ses membres et ses pieds aussi tranquillement qu'elle." Chacun accordait une plus grande attention à la position des membres et des pieds. Je les ai regardés en souriant : « Oui, mais ils ne peuvent jamais être aussi silencieux que les siens. Vous bougez un peu, mais elle, pas du tout ; aucun de vous ne peut être aussi silencieux qu'elle. » Les enfants avaient l'air sérieux. L'idée de la supériorité de la petite maîtresse semblait leur être parvenue. Certains d'entre eux souriaient et semblaient dire des yeux que les langes méritaient tout le mérite. « Aucun de vous ne peut se taire, sans voix comme elle. » Silence général. « Il n'est pas possible d'être aussi silencieux qu'elle, car, écoutez sa respiration comme elle est délicate ; approchez-vous d'elle sur la pointe des pieds."
Plusieurs enfants se levèrent et s'avancèrent lentement sur la pointe des pieds, penchés vers le bébé. Grand silence. "Aucun d'entre vous ne peut respirer aussi silencieusement qu'elle." Les enfants se regardaient émerveillés, ils n'avaient jamais pensé que même assis tranquillement ils faisaient du bruit et que le silence d'un petit bébé est plus profond que le silence des adultes. Ils ont presque cessé de respirer. Je me levai. "Sortez tranquillement, tranquillement," dis-je, "marchez sur la pointe des pieds et ne faites pas de bruit." En les suivant, j'ai dit : « Et pourtant j'entends encore des bruits, mais elle, le bébé, marche avec moi et ne fait aucun bruit. Elle sort en silence. Les enfants ont souri. Ils ont compris la vérité et la plaisanterie de mes paroles. Je suis allé à la fenêtre ouverte et j'ai placé le bébé dans les bras de la mère qui nous regardait.
La petite semblait avoir laissé derrière elle un charme subtil qui enveloppait l'âme des enfants. En effet, il n'y a rien de plus doux dans la nature que la respiration silencieuse d'un nouveau-né. Il y a une majesté indescriptible dans cette vie humaine qui, dans le repos et le silence, acquiert force et nouveauté de vie. Comparée à cela, la description de Wordsworth de la paix silencieuse de la nature semble perdre de sa force. « Quel calme, quel silence ! Le seul son est le goutte à goutte de la rame suspendue. Les enfants aussi ont ressenti la poésie et la beauté dans le silence paisible de la vie humaine naissante.
> ##### **La licence de cette page :**
>
> Cette page fait partie du « **Projet de restauration et de traduction Montessori** ».\
> Veuillez [soutenir](https://ko-fi.com/montessori) notre initiative " **Éducation Montessori tout compris pour tous 0-100+ dans le monde** ". Nous créons des ressources ouvertes, gratuites et abordables disponibles pour tous ceux qui s'intéressent à l'éducation Montessori. Nous transformons les personnes et les environnements pour qu'ils soient authentiques Montessori dans le monde entier. Merci!
>
> [](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
>
> **Licence :** Ce travail avec toutes ses modifications de restauration et traductions est sous licence [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) .
>
> Consultez l' **historique** des pages de chaque page wiki dans la colonne de droite pour en savoir plus sur tous les contributeurs et les modifications, restaurations et traductions effectuées sur cette page.
>
> [Les contributions](https://ko-fi.com/montessori) et les [sponsors](https://ko-fi.com/montessori) sont les bienvenus et très appréciés !
* [La méthode Montessori, 2e édition](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/French "La méthode Montessori sur la zone Montessori - Langue anglaise") - Restauration en français - [Archive.Org](https://archive.org/details/montessorimethod00montuoft/ "La méthode Montessori sur Aechive.Org") - [Open Library](https://openlibrary.org/books/OL7089223M/The_Montessori_method "La méthode Montessori sur la bibliothèque ouverte")
* [0 - Index des chapitres - La méthode Montessori, 2e édition - Restauration - Bibliothèque ouverte](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/0+-+Index+des+chapitres+-+La+m%C3%A9thode+Montessori%2C+2e+%C3%A9dition+-+Restauration+-+Biblioth%C3%A8que+ouverte)
* [Chapitre 00 - Dédicace, remerciements, préface à l'édition américaine, introduction](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+00+-+D%C3%A9dicace%2C+remerciements%2C+pr%C3%A9face+%C3%A0+l%27%C3%A9dition+am%C3%A9ricaine%2C+introduction)
* [Chapitre 01 - Une réflexion critique sur la nouvelle pédagogie dans son rapport à la science moderne](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+01+-+Une+r%C3%A9flexion+critique+sur+la+nouvelle+p%C3%A9dagogie+dans+son+rapport+%C3%A0+la+science+moderne)
* [Chapitre 02 - Histoire des méthodes](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+02+-+Histoire+des+m%C3%A9thodes)
* [Chapitre 03 - Discours inaugural prononcé à l'occasion de l'ouverture d'une des « Maisons des Enfants »](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+03+-+Discours+inaugural+prononc%C3%A9+%C3%A0+l%27occasion+de+l%27ouverture+d%27une+des+%C2%AB+Maisons+des+Enfants+%C2%BB)
* [Chapitre 04 - Méthodes pédagogiques utilisées dans les « Maisons des enfants »](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+04+-+M%C3%A9thodes+p%C3%A9dagogiques+utilis%C3%A9es+dans+les+%C2%AB+Maisons+des+enfants+%C2%BB)
* [Chapitre 05 - Discipline](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+05+-+Discipline)
* [Chapitre 06 - Comment la leçon doit être donnée](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+06+-+Comment+la+le%C3%A7on+doit+%C3%AAtre+donn%C3%A9e)
* [Chapitre 07 - Exercices pour la vie pratique](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+07+-+Exercices+pour+la+vie+pratique)
* [Chapitre 08 - Réflexion sur l'alimentation de l'enfant](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+08+-+R%C3%A9flexion+sur+l%27alimentation+de+l%27enfant)
* [Chapitre 09 - Gymnastique d'éducation musculaire](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+09+-+Gymnastique+d%27%C3%A9ducation+musculaire)
* [Chapitre 10 - La nature dans l'enseignement du travail agricole : Culture des plantes et des animaux](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+10+-+La+nature+dans+l%27enseignement+du+travail+agricole+%3A+Culture+des+plantes+et+des+animaux)
* [Chapitre 11 - Le travail manuel l'art du potier, et la construction](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+11+-+Le+travail+manuel+l%27art+du+potier%2C+et+la+construction)
* [Chapitre 12 - L'éducation des sens](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+12+-+L%27%C3%A9ducation+des+sens)
* [Chapitre 13 - Education des sens et illustrations du matériel didactique : Sensibilité générale : Les sens tactiles, thermiques, basiques et stéréognostiques](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+13+-+Education+des+sens+et+illustrations+du+mat%C3%A9riel+didactique+%3A+Sensibilit%C3%A9+g%C3%A9n%C3%A9rale+%3A+Les+sens+tactiles%2C+thermiques%2C+basiques+et+st%C3%A9r%C3%A9ognostiques)
* [Chapitre 14 - Notes générales sur l'éducation des sens](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+14+-+Notes+g%C3%A9n%C3%A9rales+sur+l%27%C3%A9ducation+des+sens)
* [Chapitre 15 - Education intellectuelle](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+15+-+Education+intellectuelle)
* [Chapitre 16 - Méthode d'enseignement de la lecture et de l'écriture](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+16+-+M%C3%A9thode+d%27enseignement+de+la+lecture+et+de+l%27%C3%A9criture)
* [Chapitre 17 - Description de la méthode et du matériel didactique utilisé](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+17+-+Description+de+la+m%C3%A9thode+et+du+mat%C3%A9riel+didactique+utilis%C3%A9)
* [Chapitre 18 - Le langage dans l'enfance](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+18+-+Le+langage+dans+l%27enfance)
* [Chapitre 19 - Enseignement de la numération : Introduction à l'arithmétique](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+19+-+Enseignement+de+la+num%C3%A9ration+%3A+Introduction+%C3%A0+l%27arithm%C3%A9tique)
* [Chapitre 20 - Séquence d'exercice](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+20+-+S%C3%A9quence+d%27exercice)
* [Chapitre 21 - Révision générale de la discipline](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+21+-+R%C3%A9vision+g%C3%A9n%C3%A9rale+de+la+discipline)
* [Chapitre 22 - Conclusions et impressions](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+22+-+Conclusions+et+impressions)
* [Chapitre 23 - Illustrations](https://montessori-international.com/s/the-montessori-method/wiki/Chapitre+23+-+Illustrations)